 |
|
|
 |
La
césure
L'arbre est employé comme césure dès le IXe
siècle. C'est ainsi qu'est scandé le récit en images dans la Bible de Charles le
Chauve. Les arbres-césure se distinguent en général assez bien des arbres du
paysage naturel. Au XIIe siècle, dans la Bible de Burgos, les arbres du
paradis terrestre se reconnaissent à leurs larges frondaisons tandis que l'arbre-césure
est mince et son feuillage stylisé en palmette. Dans des bibles romanes, comme dans la
" tapisserie " de Bayeux, où il est systématiquement utilisé,
l'arbre-césure présente en général un seul tronc mais sa frondaison est plus
élaborée, ses branches étroitement entrelacées.
Si l’arbre est progressivement supplanté par les colonnes à partir des XIe-XIIe
siècles, il est encore utilisé au milieu du XIIIe siècle. Dans le Psautier
de saint Louis, au milieu d'une série de colonne, se trouve un magnifique arbre au
tronc linéaire mais dont le feuillage, traité de manière
" naturaliste ", s'insère dans les hautes arcatures gothiques qui
forment l'encadrement des pages. L’arbre-césure est encore pratiqué dans le roman
de Fauvain, au début du XIVe siècle et même vers 1500 : ainsi sont
séparés les épisodes dans la tapisserie de la vie de saint Etienne (Paris, Musée
National du Moyen Âge). Le procédé, presque antique, est promis à un bel avenir :
dans les années 1970, Tove Jansson le réinventera dans ses Moomines. |
 |
|
|

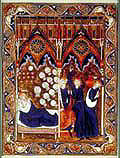
|
|
Après l’arbre,
l'architecture est le second procédé de césure inventé par les artistes médiévaux.
Dans le Pentateuque de Tours, au VIIe siècle, les épisodes de certaines pages
sont enclos chacun dans un bâtiment carré ouvert au regard. Plus stylisé au XIe
siècle, le procédé s'affine : c'est une tour étroite qui sert de coupure entre
certaines des scènes de la broderie de Bayeux. Dans une bible bavaroise du dernier quart
du XIIe siècle, les six cases d'une page forment un bâtiment à trois étages
et à six pièces dont les encadrements supérieures sont d'étroites tours crénelées.
Les artistes du XVe siècle ajouteront à cette mise en page, restée à la
mode, la profondeur due à leur maîtrise acquise de la perspective.
Version stylisée d’architectures plus complexes, la colonne devient vite très
pratique pour séparer les épisodes. Tordue ou cannelée, elle est employée dans les
fresques romanes italiennes, dans les mosaïques de Florence ou de Venise, dans les
manuscrits français du XIIIe siècle. D'abord massive au XIIe
siècle, la colonne se fait fine et élancée au XIIIe siècle, proche d'une
simple ligne de séparation entre les cases. En revanche, la colonne retrouve son
caractère architectural massif au XVe siècle, comme dans la prédelle du Miracle
de l'Hostie de Paolo Uccello.
|
|