 |

Sur les distances et
les grandeurs du
Soleil et de la Terre |
 |
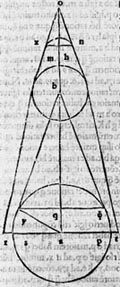
détail |
|
Le progrès intellectuel
L'idée que le cosmos puisse être sphérique marque un progrès important
par rapport à la conception antérieure d'une voûte céleste. L'univers
semble tourner d'un mouvement régulier et le premier ouvrage d'astronomie
antique qui nous soit parvenu, La sphère en mouvement (Autolycos
de Pitane, 330 av. J.-C.), montre que cette sphère apparait différente
suivant les lieux d'où on l'observe : au pôle, les étoiles ne se
lèvent ni ne se couchent, mais tournent concentriquement autour
de la Polaire ; à l'équateur, toutes se lèvent et se couchent
perpendiculairement à l'horizon, et entre les deux, leur trajet
est oblique. Euclide explique que les étoiles sont en fait très
éloignées et que la Terre est réductible à un point dans l'espace ; tout observateur voit donc une moitié de la sphère céleste.
Le ciel sphérique, lui-même constitué de sept sphères planétaires
emboîtées (Lune, Vénus, Mercure, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne)
et de celle du firmament, conduit logiquement à l'idée du géocentrisme.
Au centre de cet univers rond, la Terre ne peut tomber ni dans un
sens ni dans l'autre ; en équilibre, elle est donc immobile.
Sinon, explique Ptolémée, elle sortirait du ciel, les oiseaux en
vol se perdraient et la pierre lancée verticalement en l'air ne
retomberait pas à son point de départ.
|