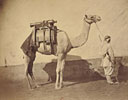|
|
Il subsiste bien des blancs dans ce canevas, en dépit
de tous les documents, connus ou inédits, qui ont pu être rassemblés.
Surtout, nous ne savons rien de la peinture de Le Gray : aucun tableau
n'a encore été identifié, alors qu'il en a produit durant toute sa vie.
Rien n'indique que ces œuvres aient été de grande qualité, mais leur connaissance
aurait été précieuse pour mieux comprendre un artiste qui s'est toujours
dit peintre, et dont les photographies portent la marque d'une réflexion
profondément picturale. Car c'est bien là, au-delà des événements d'une
vie, le lien primordial entre l'homme et l'œuvre qui doit être souligné
: l'ambition artistique, l'extension à la photographie d'exigences apprises
chez Paul Delaroche, au Louvre, à Rome,
puis développées dans un commerce constant avec les peintres contemporains.
Mieux comprendre l'ascension, la chute et le travail du photographe le
plus doué de son temps, c'est éclairer aussi l'ambition et le destin d'une
génération qui a donné à la photographie son âge d'or. Le rôle central
de Le Gray, au carrefour de l'art, de la science, du commerce et du pouvoir,
dans la genèse du monde de la photographie sous le Second Empire, voire
dans l'élévation de la photographie au rang d'un art, permet de poser
des questions historiques et artistiques qui dépassent l'individu. La
moindre n'est pas celle du style en photographie, fait de technique autant
que d'esthétique : entre le maître et les disciples, les attributions
peuvent être délicates à trancher.
|
![]()