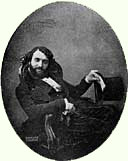Les premières œuvres désormais connues sont des plaques
de daguerréotype de la période 1847-1848. Deux peuvent être situées en
1848. Il s'agit du portrait du fils de l'architecte Charles Le Cœur :
le jeune Pol Le Cœur, collégien au lycée Henri-IV, sourit avec gentillesse
et spontanéité à l'objectif. Puis c'est la reproduction d'un tableau de
l'ami Gérôme, Anacréon, Bacchus et l'Amour, présenté au Salon de
1848, aussitôt acheté par l'État pour le musée de Toulouse et photographié
avant le transfert ; il porte une signature manuscrite au poinçon
sur la plaque daguerrienne : "Gustave Le Gray d'après Gérôme". Le
choix de Le Gray pour affronter la difficulté de reproduire une toile
de grand format sur un daguerréotype en pleine plaque et l'exceptionnelle
qualité technique du résultat prouvent qu'il n'en est pas à son coup d'essai.
D'autres portraits remontent à cette période, et les modèles appartiennent
déjà au meilleur monde : ainsi trois jeunes garçons inconnus mais
visiblement de riche extraction, en habit, et un portrait de jeune fille.
Il photographie aussi le cercle de ses intimes : Henri Le Secq ou
ses parents.