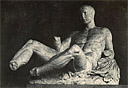|
 |
Le calotype est un procédé
photographique sur papier, et désigne à la fois
le négatif et le positif. Il est mis au point en 1840
par l’anglais William Henry Fox Talbot (1800-1877), après
plusieurs années de tâtonnements qui, de 1834 à
1839, lui ont permis de constater les propriétés
noircissantes de la lumière sur les sels d’argent
– l’expression la plus aboutie en étant les
"dessins photogéniques", simple empreinte en
réserve d’un objet posé sur une feuille
traitée puis exposée au soleil.
|
 |
|
Le
procédé
Le support du calotype est une feuille de papier dont la surface
est enduite au pinceau d’une solution de nitrate d’argent.
La feuille est ensuite séchée puis immergée
dans un bain d’iodure de potassium ; la formation d’iodure
d’argent qui en résulte est nécessaire à
la sensibilisation du support. Une solution de gallo-nitrate
d’argent lui est appliquée en dernier lieu, avant
que la feuille ne soit introduite, sèche ou encore humide,
dans un châssis. La feuille, placée dans la chambre
noire, est alors exposée à la lumière directe
pendant une à plusieurs minutes. Après cette courte
exposition, l’image est encore latente, car les sels d’argent
ne noirciront qu’après avoir été
soumis à l’action accélératrice d’un
bain de gallo-nitrate d’argent. L’image apparue
en négatif est ensuite lavée puis fixée
dans une solution d’hyposulfite de soude.
L’image "positive" s’obtient par une dernière
opération : la mise en contact du négatif et d’un
papier salé – c’est-à-dire enduit
de chlorure de sodium et de nitrate d’argent puis séché
– les deux feuilles sont maintenues l’une contre
l’autre dans un châssis-presse puis sont exposées
au soleil, négatif dessus. L’image positive ainsi
révélée est finalement fixée à
l’hyposulfite de sodium.
|
 |
|
Avantages
techniques et esthétiques
Le calotype présente donc un certain nombre de particularités,
qui sont autant d’avantages en regard du daguerréotype,
le procédé contemporain du français Daguerre.
Alors que ce dernier est un positif direct sur plaque de cuivre
argenté et donc non reproductible, le calotype offre
la possibilité de tirer, à partir d’un négatif
papier, un nombre théoriquement infini d’épreuves
positives. L’autre attribut essentiel du calotype tient
à ce que l’image, latente, peut être révélée
dans un second temps, ce qui confère au procédé
une certaine souplesse, une distinction étant désormais
faite entre la prise de vue et le développement de l’image,
ce qui sera un des traits majeurs de la photographie moderne.
Mais au-delà de la commodité du procédé,
le calotype tire de la nature de son support le fondement même
de son esthétique. La texture fibreuse, grenue du papier
donne en effet à l’image un moelleux, une résonance
veloutée qui emporte d’emblée l’adhésion
des artistes. Les contrastes d’ombre et de lumière
sont accentués – les ombres portées sont
très noires – en même temps que les contours
semblent avoir été passés à l’estompe
; on songe alors à une œuvre produite de la main
même d’un artiste, au crayon, au lavis ou à
l’aquatinte.
|
| |
|
Diffusion
Cependant, alors que le daguerréotype a atteint une certaine
maniabilité, le calotype est à ses débuts
un procédé complexe, aléatoire, long. Et,
tandis que l’invention de Daguerre est tombé dans
le domaine public, Talbot fait breveter le calotype en 1841
; sa diffusion s’en trouve durablement entravée,
contrariant ainsi d’éventuelles améliorations
et un usage commercial. En 1844-1846, Talbot tentera tout de
même de démontrer l’originalité de
son procédé en éditant The Pencil
of Nature, le premier livre imprimé illustré
de photographies originales collées, faisant ainsi la
preuve de l’utilité de la photographie comme technique
d’illustration. Hormis Talbot, et malgré les exigences
de celui-ci, quelques amateurs adopteront le calotype. Les plus
remarquables sont les Ecossais David Octavius Hill – qui
est peintre – et Robert Adamson, qui produiront ensemble,
dans le courant des années 1840, de nombreux calotypes
: séries de portraits de personnalités, puis portraits
de groupes, scènes de genre, paysages. Leur œuvre,
bien qu’imposante, ne sera redécouverte qu’à
la fin du XIXe siècle.
La fortune du calotype étant en Angleterre limitée
par le brevet de Talbot, c’est en France qu’il connaîtra
un véritable essor. Dès le début de l’année
1839, le Français Hippolyte Bayard, indépendamment
des travaux de Talbot, et devançant même ce dernier,
parvient, à la suite d’un certain nombre d’essais,
à obtenir des images positives directes sur papier, d’une
qualité exceptionnelle. Il est déjà parvenu
à produire des négatifs, dont il a même
tiré quelques épreuves positives, mais il leur
préfère les images positives directes, au moment
même où le procédé positif de Daguerre
remporte ses premiers succès. Pouvant être considéré
comme un des inventeurs du calotype, Bayard ne se sent nullement
gêné par le brevet de Talbot. Au cours des années
1840, Bayard et le baron Humbert de Molard, lui aussi calotypiste
amateur, savent puiser dans les ressources du procédé
de quoi alimenter une vision personnelle, tant dans le choix
que dans le traitement des sujets, notamment des scènes
de genre. Mais ce n’est qu’après son perfectionnement
par les Français Louis-Désiré Blanquart-Evrard
(en 1847) et Gustave Le Gray (en 1851) que le calotype accédera
à son âge d’or. En effet, à l’issue
d’une période de maturation ayant couru sur près
d’une décennie, l’année 1851 se révèlera
être décisive quant à l’essor véritable
du calotype. |
|
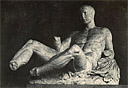 |
|
Blanquart-Evrard
Négociant en draps mais surtout chimiste amateur, Blanquart-Evrard,
tout en préservant les caractéristiques premières
du calotype – image "négative", image latente – améliore notablement la qualité du support et les procédures
: plutôt que d’appliquer de manière irrégulière
la solution de sels d’argent au pinceau, Blanquart-Evrard y
fait flotter le papier, dont la surface se trouve dès lors
uniformément imprégnée. Il apporte aussi davantage
de soin au lavage des épreuves, qui dès lors résistent
mieux au pâlissement. C’est donc à une rationalisation
du procédé de Talbot que tend Blanquart-Evrard, qui
espère pouvoir industrialiser la production, notamment grâce
à des papiers préparés à l’avance,
prêts à être emportés et exposés.
En 1851, répondant aux vœux de la Société
Héliographique fondée la même année à
Paris, Blanquart-Evrard crée une imprimerie photographique
à Loos-lès-Lille. Il y éditera des albums thématiques regroupant des tirages
d’après des négatifs papier obtenus auprès des
plus grands praticiens de l’époque, amis, amateurs ou
professionnels, en un nombre et pour un coût qu’il veut
satisfaisant. Plusieurs dizaines de milliers de tirages sortiront
de l'imprimerie photographique jusqu’à ce que Blanquart-Evrard, incapable d’équilibrer
les coûts de production et le prix de vente, ne doive se résoudre
à la fermeture de l’imprimerie, en 1855. Les sujets des
tirages vont des vues de monuments et de paysages, des évocations
de la vie rurale ou encore des reproductions de tableaux. C’est
par l'intermédiaire de cette entreprise qu’a pu nous parvenir une bonne part
des épreuves de Charles Marville, Louis Robert ou encore Victor
Regnault.
|
 |
|
Gustave Le
Gray
Cette même année 1851, Gustave Le Gray, artiste peintre
et photographe féru d’expérimentations techniques,
assure pour quinze ans la pérennité du calotype par
l’invention du papier ciré sec : le papier est sensibilisé
par trempage dans de la cire d’abeille fondue, devenant ainsi
plus uniformément perméable aux préparations
chimiques, plus sensible, plus lisse et légèrement transparent
; il est alors à même de rivaliser en netteté
avec la plaque de verre au collodion, le procédé qui,
dès 1852, a commencé à remplacer avantageusement
le daguerréotype. Mais quand ce dernier est un procédé
humide nécessitant le transport d’un laboratoire itinérant,
les plaques devant être préparées immédiatement
avant la prise de vue et développées tout de suite après,
le papier ciré présente l’avantage de pouvoir
être préparé à l’avance puis d’être
traité sec, dans un délai de plusieurs jours après
l’exposition. Le papier ciré sec a cependant pour inconvénient
la longueur du temps d’exposition, ce qui limite son usage aux
sujets inanimés ou posés plutôt qu’à
la représentation de figures en mouvement, pour laquelle Charles
Nègre et Le Gray lui-même utiliseront la plaque de verre
au collodion, notamment lors de leurs reportages à l’asile
impérial de Vincennes (1858) pour le premier, au camp militaire
de Châlons-sur-Marne (1857) pour le second.
|
 |
|
Fortune
Contrairement au collodion, dont l’invention est révélée
en 1851 et dont le large circuit de diffusion passera surtout par
les ateliers commerciaux, restant aux mains des photographes professionnels,
le calotype devient naturellement le médium favori des amateurs
d’art fortunés, et ceux des calotypistes qui en vendent
sont avant tout des artistes, tels Le Gray, Baldus, Le Secq et Mestral.
Ces derniers participent à la Mission héliographique
de 1851, commanditée par la Commission des Monuments historiques,
lors de laquelle ils utilisent de façon systématique
le calotype. Parmi eux se trouve également le calotypiste de
la première heure Bayard, mais ce dernier préfère
alors utiliser la plaque de verre. Les cinq praticiens sont envoyés
dans les régions de France par la Commission afin de dresser
l’inventaire des monuments les plus remarquables nécessitant
restauration. La Mission héliographique est une étape
décisive qui assied l’intérêt documentaire
de la photographie mais révèle aussi avec évidence
les qualités pratiques et esthétiques du calotype.
Par son peu d’encombrement – le papier étant plus
aisé à transporter qu’une plaque de cuivre ou
de verre – mais aussi par la qualité de ses contrastes,
le rendu des matières et des surfaces, le traitement des profondeurs
atmosphériques, la palpitation de la lumière qui affleure
sur chaque épreuve, le calotype se révèle remarquablement
adapté à la photographie d’architecture, de paysage
ou de natures mortes. Il devient naturellement le médium léger
et peu coûteux des voyageurs, le précieux auxiliaire
d’une génération partie à la découverte
de l’Orient rêvé : l’écrivain Maxime
Du Camp, ami de Flaubert en compagnie duquel il voyage en Egypte (de
1849 à 1851), l’archéologue Salzmann, qui parcourt
la Terre Sainte (en 1853), et l’égyptologue Devéria
(en 1859) enregistrent ainsi ce qu’ils espèrent être
un témoignage fidèle de ce qu’ils ont vu. Les
artistes et les flâneurs s’emparent également du
calotype avec enthousiasme ; la sensibilité, la fraîcheur
de vision, l’aspiration à une représentation authentique
des choses dont font preuve les calotypistes comme Eugène Cuvelier
rencontre spontanément celle des peintres paysagistes de Barbizon,
qui ont fait de la nature vierge leur sujet de prédilection.
Peu à peu, un nouveau langage esthétique se fait jour,
ses praticiens ne se lassant d’en découvrir la richesse
des nuances et la souplesse d’interprétation.
La vibration qui émane de ces "dessins par la lumière"
ne doit pas occulter la lenteur et la minutie avec lesquelles doit
se pratiquer le calotype. La raison d’être des cercles
d’amateurs qui se forment alors, dont le plus important est
la Société héliographique, vient autant du désir
de partager une passion commune que de la nécessité
d’échanger les dernières recettes et tours de
main. La Société héliographique facilite la diffusion
du procédé par les échanges qu’elle suscite,
lors des réunions qu’elle organise ou par l’entremise
de la revue La Lumière, qu’elle publie. La calotypie
reste, à l’instar de tout les procédés
photographiques avant 1880, un procédé artisanal, abouti
tout en étant éminemment perfectible, aux résultats
heureusement aléatoires, aux effets modulables, notamment grâce
à la possibilité d’effectuer des retouches sur
le négatif papier. Cela laisse à celui qui a appris
à le manipuler une amplitude d’expression qu’il
peut solliciter tout au long des étapes du processus photographique.
|

|
 |
Déclin
Or, par ses sujets autant que par ses modalités, le calotype
ne saura pas s’imposer au-delà d’un cercle éclectique
et élitiste, où se côtoient des amateurs venus
de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie, des scientifiques,
des hommes de lettres et des artistes de formation, tous esthètes
férus de manipulations chimiques, restés en marge
de la pratique commerciale de la photographie au collodion. Parmi
eux se croisent aussi des professionnels qui, comme Charles Nègre,
Charles Marville ou Henri Le Secq, veillent à ne pas renier
leurs ambitions artistiques. Dès 1855, le calotype connaît
un certain déclin : fermeture de l’imprimerie photographique
par manque de rentabilité devant l’essor des nouvelles
techniques d’impression des photographies ; avènement
du négatif sur verre au collodion, auquel se convertit la
Société héliographique – devenue en 1854
Société française de photographie. Certains
praticiens, tels Le Secq en 1856, sont pourtant à ce point
attachés aux ramifications artisanales du calotype qu’ils
préféreront abandonner la photographie plutôt
que d’adopter le collodion, tant ils auraient perdu en souplesse
ce qu’ils auraient gagné en rapidité, en temps
de pose réduit et en netteté. Après 1855, Le
calotype continuera cependant à être employé
par les photographes voyageurs, et ce jusqu’au début
des années 1860.
De ce moment de grâce subsistera cependant la cohérence
d’une vision et d’une technique, intimement liées
dans l’esprit de ses praticiens, et dont la qualité
de la production est un temps fort de l’histoire de la photographie.
|
|