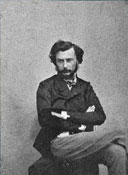|

|
L'installation à la barrière de Clichy
sera décisive dans l'évolution de la carrière de
Le Gray. Ce n'est pas seulement une nouvelle adresse, c'est aussi le lieu
où Le Gray va réorganiser sa vie en fonction d'une nouvelle
orientation donnée à son métier d'artiste, de photographe,
de professeur et de chercheur.
La maison était une ample et lumineuse bâtisse, isolée
de toutes parts, aménagée dès l'origine en ateliers
pour artistes. La façade regardant au nord, vers l'enceinte, s'ouvrait
au rez-de-chaussée et à l'étage par de vastes verrières.
La couverture était en terrasse, ce qui permit peut-être
à Le Gray d'en aménager une partie pour ses besoins, l'éclairage
le plus abondant étant alors indispensable à un photographe
pour effectuer des tirages sous châssis. L'arrière était
occupé par des logements.
La première édition de son manuel (juin 1850), qui s'ouvrait
sur cette proclamation : "L'avenir de la photographie est tout
entier dans le papier", se terminait par une annonce : "Tous
les jours je mets ces procédés en pratique dans mon grand
atelier de photographie, chemin de ronde de la barrière de Clichy;
j'engage donc les personnes qui pourraient être arrêtées
par quelques difficultés à m'y venir visiter, je me ferai
un plaisir de leur donner les renseignements qui pourraient leur manquer,
et de leur faire voir mes collections d'épreuves faites par ces
procédés."
Après les premiers élèves de la rue de Richelieu,
en tout cas, des novices plus nombreux étaient donc fermement attendus
chez Le Gray. Ces élèves ne brillèrent pas que par
le nombre, mais aussi par la naissance, la fortune et surtout le talent
(parfois les trois) : beaucoup d'entre eux étaient destinés
à laisser des noms illustres dans l'histoire de la photographie.
L'atmosphère de ce creuset social et artistique où ils se
retrouvèrent évoquait un atelier des Beaux-Arts plutôt
qu'un salon.
Les cours du maître étaient bien payés, même
s'il ne refusait pas d'accorder à certains un "prix d'ami".
On conçoit que seuls de riches amateurs ou de futurs photographes
professionnels résignés à un investissement important
aient fréquenté les lieux.
Parmi les premiers arrivés, on compte Henri Le Secq, Charles Nègre,
Mestral, Édouard Bocher (beau-frère de Léon de Laborde),
Firmin Eugène Le Dien (ami de Charles Bocher, le frère d'Édouard),
Eugène Piot, Victor Place, Olympe Aguado, Édouard et Benjamin
Delessert, le marquis de Béranger, le vicomte Vigier, John B. Greene,
Félix Avril, Emmanuel Peccarère, le comte d'Haussonville,
Sauveur, Girard, Jules Clément, notaire honoraire, et, en voisin,
Boissard de Boisdenier.
Ensuite, selon une chronologie qu'il est souvent difficile de préciser :
le vicomte Odet de Montault et sa belle-mère la vicomtesse de Montbreton,
Tranchant, Léon Méhédin, le graveur Adolphe Bilordeaux,
le peintre Lodoïsch Crette Romet, le mystérieux Anglais W.
H. G., un Rothschild, La Beaume, le duc de Montesquiou, le comte Branitski,
la comtesse d'Essertein, Mlle Dosne, Badeigts
de Laborde, Dumas de Lavince, Félix Nadar, son frère Adrien
Tournachon, Mayal, Gueybbard, Mugnier, Courtais, Delatre, Henri de La
Blanchère, Édouard de Latreille, Léon Delaporte,
Eugène Colliau et Alexandre Janneau.
Si l'on a pu répertorier nommément une petite cinquantaine
d'élèves, on est obligé d'en supposer d'autres encore :
l'enseignement fut probablement la principale source de revenus du photographe
durant quelques années, à une époque où beaucoup
voulaient se lancer dans la photographie sur papier et où manquaient
les ateliers déjà installés qui auraient été
en mesure, comme Bertsch et Arnaud par exemple, de former des professionnels.
La pléiade d'artistes initiée par Le Gray allait apporter
une contribution décisive au vigoureux essor de la profession à
Paris vers 1852-1855.
Un des apports majeurs de Le Gray à la photographie, outre son
œuvre propre, est d'avoir formé une génération
de photographes de talent. La plupart de ces photographes sont bien connus
déjà des spécialistes, certains même du grand
public. D'autres comme Eugène Le Dien sont inconnus. L'œuvre
de ce jeune magistrat, brillant élève de Le Gray, a jusqu'ici
été ignorée, mal attribuée voire attribuée
à Le Gray lui-même.
|