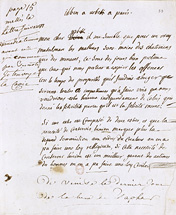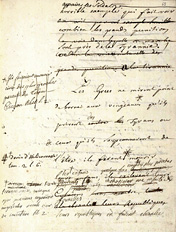L'homme au centre du monde
Pierre Malandain
À bien des égards, Montesquieu peut apparaître comme le type même du "philosophe" de la première moitié du XVIIIe siècle. À un intérêt précoce et persévérant pour la spéculation appliquée aux problèmes bien concrets du bonheur des hommes et des équilibres de leur vie en groupe, il allia en effet une pratique sociale qui le mit en contact expérimental avec à peu près toutes les réalités possibles : la culture classique, le nouvel élan "moderne", l'exercice du droit, les objets de l'histoire naturelle, l'exploitation de terres et de vignes, la gestion d'un patrimoine, la dissipation mondaine, le succès parisien, le "grand tour" européen, le monde des livres, le divertissement d'une écriture libertine, la maturation longue et épuisante d'un immense projet intellectuel. Sur tout ce qui pouvait occuper un homme de ce temps il exerça une curiosité tenace ("Tout m'intéresse, tout m'étonne", fera-t-il dire à Usbek), si bien qu'il aborda à lui seul dans sa vie tous les objets qu'on a vu retenir chacun de ses contemporains. Cela n'alla certes pas sans contradictions : malgré la sérénité dont il est resté une sorte d'emblème, malgré la jouissance d'un bonheur qui semble lui avoir été donné avec une évidence tranquille, et dont témoignent ses Pensées, il n'ignore pas que ces merveilleuses acquisitions dont il voit tout le monde autour de lui s'emparer, s'orner, se targuer, la nature, la raison, la liberté, ne sont que des principes ; que le savoir n'est lui-même qu'une virtualité et que ses constructions sont toujours relatives. Le plus grand Montesquieu est peut-être le moraliste – quoiqu'il n'ait écrit aucun ouvrage suivi de morale – parce que tout chez lui a dépendu de cette exigence avec laquelle il a habité ces principes, incarné cette virtualité, maintenu les équilibres par l'exercice d'une volonté lucide et vigilante. En cela aussi il accomplit dans sa vraie et totale dimension le projet des Lumières naissantes : mettre l'homme au centre du monde, c'était lui reconnaître des droits nouveaux, mais aussi lui découvrir de nouveaux devoirs. Morale moins austère et grave ("la gravité est le bouclier des sots") qu'enjouée et stimulante, car c'est elle qui va mettre en branle une enquête passionnée sur tout, sur les rapports de chaque chose avec les autres, pour l'intelligence du monde humain. La philosophie, pour Montesquieu, c'est ce qui "a des rapports avec tout".
Dessiner la perspective ordonnée de cette œuvre multiple n'est pas facile pour trois raisons principales, dont l'énoncé même, pourtant, suggère une perspective possible, dans un autre ordre où la rationalité joue moins le rôle de repère fixe et d'instrument sûr que de leurre indispensable et toujours insaisissable : une raison idéologique (la poursuite d'une lisibilité complète du politique est toujours à la fois interrompue et relancée par le refus de tout système totalisant), une raison éthique (l'analyste ne fait jamais abstraction de lui-même et croit de sa dignité d'homme de réintroduire le jugement subjectif dans l'examen objectif des faits), et une raison esthétique (grand artiste rococo, Montesquieu professe que "pour bien écrire, il faut sauter les idées intermédiaires"). Le postulat de base est simple : "Ce n'est pas la fortune qui domine le monde. » Il renvoie dos à dos ceux qui sont toujours prêts à donner à cette fortune le nom de Providence (Bossuet par exemple) et ceux qui, la référant au pur hasard, renoncent à toute possibilité de la connaître, de la prévoir ou d'agir sur elle (les pyrrhoniens convaincus, ou simplement tactiques comme Pascal). Non la fortune, donc, mais un enchaînement de causes et d'effets, un système de gravitation qu'on devrait pouvoir calculer. Les trois grands ouvrages de Montesquieu sont autant de jalons de ce calcul, ou plutôt d'expériences visant à en affiner la méthode.
Les Lettres persanes
Expérience, d'abord, d'un départ. Riche et puissant seigneur d'Ispahan, Usbek décide de voyager en Europe "pour aller chercher la sagesse", accompagné de son jeune ami Rica. Leur voyage les mène de Perse en Turquie, puis à Livourne et enfin à Paris, où ils découvrent une société inconnue et déroutante. Elle exerce à la fois leur verve satirique (surtout celle du jeune Rica) et leur réflexion philosophique (surtout celle d'Usbek, qui s'est mis en tête de rechercher "quel était le gouvernement le plus conforme à la raison"). L'échange épistolaire entre eux et avec leurs amis restés en Orient leur permet de confronter toutes sortes d'expériences historiques, géographiques, religieuses, sociales, politiques, et les pousse à la recherche des principes susceptibles de rendre compte de cette prodigieuse diversité. Cependant l'absence du maître a troublé la marche habituelle de son sérail, sur laquelle il ne s'était jamais posé de questions. Ce trouble amène ses femmes et ses eunuques à décrire dans le détail les principes, de plus en plus bafoués, du fonctionnement du sérail. Trop pris par ce à quoi il assiste en France, où la Régence vient de bouleverser l'ancien système politique, Usbek ne répond pas aux appels pressants qui lui sont adressés pour son retour, jusqu'au moment où, par la volonté d'une femme, sa favorite Roxane, tout explose et se termine dans un bain de sang. La structure du livre rend plausible l'hypothèse selon laquelle cette révolution finale constituerait la dernière et la plus importante des leçons qu'Usbek était allé chercher au loin, qu'il n'avait pas su voir dans sa propre maison, et qui n'a pu lui être administrée que parce que, justement, il en était parti. Mais la même structure invite aussi à mettre en relation cette catastrophe orientale et l'effondrement de l'expérience occidentale (échec du "libéralisme" politique et économique de la Régence).
L'inégalable génie des Lettres Persanes tient à une équivoque qu'aucune lecture critique ne peut lever, parce qu'elle est fondatrice de l'écriture même du livre et se retrouve à tous les niveaux de sa facture : entre le sérieux (la recherche d'un « esprit » des lois a déjà commencé et nombre de lettres sont de véritables dossiers pour cette recherche) et le plaisant (la verve satirique et parodique est insolente à souhait et comble les rieurs de tout poil) ; entre le roman ("une espèce de roman", dit ironiquement l'Avertissement de 1754) et le traité (onze lettres par exemple, de la 112e à la 122e, ne sont que le découpage d'une véritable étude sur la "dépopulation", c'est-à-dire le recul de la démographie sur le globe) ; entre la description réaliste (qui fait de ce texte un précieux document pour les historiens de la période) et le recours au mythe (à trois reprises : les fameux Troglodytes de la 11e à la 14e lettre, l'histoire d'Aphéridon et d'Astarté à la 67e lettre, et le conte d'Anaïs à la 141e lettre) ; entre la lucidité naïve (d'un regard non prévenu sur les mœurs françaises) et le naïf aveuglement (hérité d'une culture orientale non distanciée) ; entre Usbek et Rica, le vieil homme et l'homme nouveau, les deux poches de la même besace ? L'instrument principal de cette réussite est sans doute la forme épistolaire, qui rend actives toutes ces équivoques, et bien d'autres. Par le succès et l'exemple de son livre, Montesquieu a beaucoup contribué à la fortune, dans tout le siècle, de cette forme qui exalte, plus que tel message ou sa nature ou sa vérité ou sa beauté, la fonction d'échange interactif de la littérature : une relecture des "Tableaux chronologiques" des chapitres du présent ouvrage permettra de mesurer la remarquable extension de la forme-lettre dans tous les genres et au cœur vibrant du mouvement philosophique.
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
La deuxième expérience est celle d'un retour. Retour aux sources de la civilisation de l'Europe chrétienne : Rome. Après l'aventure d'un voyage ouvert à toutes les surprises, c'est maintenant le regard surplombant sur le champ entier d'une histoire close sur elle-même, celle de la croissance, de la grandeur et de la décadence des Romains. Beaucoup moins originale que la précédente, cette initiative valut aux Considérations... de Montesquieu beaucoup moins de faveur qu'aux Lettres persanes. Un grand nombre d'histoires de la Rome antique avaient fleuri, fleurissaient et devaient fleurir encore, et cela sentait son exercice d'école. L'histoire romaine de Montesquieu, pourtant, se différencie radicalement de toutes les autres. La méthode qui s'y cherche vise à faire dépendre les vicissitudes de la Cité, non plus d'un cycle fatal menant toute chose vivante successivement à l'accroissement, à la maturité, à la déperdition et à la mort, ni d'une action décisive des grandes personnalités historiques (Scipion, Caton pour la grandeur, César et ses successeurs pour la décadence), mais de la logique interne d'un jeu de causes complexes, matérielles et morales, dont le dispositif d'ensemble, composant les variations de chacun de ses éléments, finit par entraîner la Cité dans un sens ou dans l'autre. Tenant encore du roman (l'examen d'une seule civilisation aligne ses expériences successives comme une histoire à rebondissements, et, comme le Fénelon de Télémaque avec les sages Grecs, Montesquieu suit avec un intérêt passionné les aventures de ses "chers Romains"), les Considérations annoncent déjà, malgré leur spécification historique, la généralisation de l'enquête et son inscription dans toute l'amplitude de l'espace philosophique.
De l'Esprit des lois
La troisième expérience, en effet, mobilisa plus de moyens et d'énergie que les deux autres réunies, trop même sans doute pour un seul homme, qui s'y épuisa. Elle aboutit à une somme magistrale (prise en charge de toutes les institutions et habitudes sociales de l'Antiquité, du Moyen Age, de l'Europe moderne, du Proche-, du Moyen- et de l'Extrême-Orient, des Amériques, de l'Afrique : une documentation énorme et si disparate !) qui, comme toujours chez Montesquieu, ne se présente pas comme telle, ni dans la facture (chapitres inégaux et émiettés, ruptures du propos, fragments), ni dans les conclusions (suspendues, relatives, voire contradictoires). De même qu'on simplifie couramment son titre (De l'esprit des lois ou Du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce, etc.), il est nécessaire, pour présenter L'Esprit des lois, d'en simplifier le contenu sans en trahir la démarche. L'objet est de découvrir la règle – positive, valable en tous temps et en tous lieux, déterminée par des facteurs contrôlables et mesurables – selon laquelle se constituent, fonctionnent et évoluent les institutions que fabriquent les hommes pour organiser leur vie collective.L'idée même de soumettre cet ordre de faits à une juridiction scientifique était hardie et nouvelle. Les appels à la "loi naturelle" prenaient volontiers celle-ci comme un absolu et rejetaient dans une relativité à peu près indifférenciée toutes les lois positives. Pour Montesquieu, c'est cette relativité même qu'il convient de différencier, pour que l'étude de ses variations puisse donner quelque prise sur elle, puisque aussi bien elle est la seule que rencontrent les hommes dans leur existence empirique. Relatives si l'on veut, mes lois me sont chères car c'est d'elles que dépendent ma vie et mon bonheur. Et puisqu'elles sont relatives, regardons quelles sont ces relations et comment elles agissent. Le programme épistémologique, on le voit, ne craint pas d'être à la fois historique, géographique, psychologique, sociologique, juridique, économique, politique, philosophique, moral et esthétique, bref, de postuler pour tout ce qu'on n'appelle pas encore les sciences humaines la même cohérence que celle démontrée par Newton dans le monde physique. Sans aboutir à une formulation unique et claire de cette "loi des lois", Montesquieu a fourni à ceux qui, comme lui et après lui, croient utile de la chercher nombre de concepts opératoires qui sont autant de figures poétiques. Parmi eux, la célèbre définition des divers gouvernements possibles selon la nature du pouvoir exercé, le principe de leur bon fonctionnement dans le comportement des gouvernés et la cause de leur corruption :
Comme il faut de la vertu dans une république et dans la monarchie de l'honneur, il faut de la crainte dans un gouvernement despotique : pour la vertu, elle n'est point nécessaire, et l'honneur y serait dangereux. Le pouvoir immense du prince y passe tout entier à ceux à qui il le confie. Des gens capables de s'estimer seraient en état d'y faire une révolution. Il faut donc que la crainte y abatte tous les courages et y éteigne jusqu'au moindre sentiment d'ambition (III, 9).
"Il faut" ? C'est le ton de la description fonctionnelle. Il est bien certain que Montesquieu accorde plus de valeur à la vertu ou à l'honneur qu'à la crainte. Mais la meilleure façon de lutter contre le despotisme, comme ailleurs contre le colonialisme et surtout l'esclavage (XV, 5), n'est-ce pas d'en connaître les conditions et les mécanismes ? Au reste, si ses préférences avouées vont à la monarchie, également éloignée des deux excès que sont la violence du peuple et celle du tyran, mais aussi intermédiaire entre le regret nostalgique d'un passé républicain révolu et le danger toujours menaçant de la dérive absolutiste, il ne la fige pas en un modèle abstrait et immuable : il y en eut et il y en a plusieurs réalisations, dont la française – qu'il vaut mieux s'abstenir de juger –, dont l'anglaise – que rien n'empêche d'admirer. La séparation des pouvoirs – législatif, exécutif, judiciaire – lui semble en effet avoir atteint, dans la monarchie anglaise issue de la Glorious Revolution, son degré maximum d'efficacité dans la sauvegarde des équilibres, toujours menacés.
Autre concept opératoire, celui des "climats" : par ce terme on doit entendre l'ensemble des déterminations géographiques (nature et étendue du sol, température et météorologie, productions pour la subsistance). Selon que le pays est plus grand ou plus petit, plus chaud ou plus froid, plus apte à la navigation, à l'agriculture ou à la chasse, il recourra plutôt à telle ou telle forme de gouvernement. Le despotisme, par exemple, convient davantage aux contrées chaudes, à cause du relâchement de la volonté et du goût de la mollesse voluptueuse que provoque la chaleur. Les petits territoires s'accommodent mieux de la République, où tous se connaissent, que les grands, etc. En ajoutant à ces déterminations des climats celles des traditions, des mœurs, de la démographie, des ressources, du commerce et même de la religion – qu'il ne craint pas de traiter comme un facteur parmi d'autres –, Montesquieu construit un modèle extrêmement complexe qu'il appelle l'"esprit général" d'une nation. Celui-ci influence le choix du gouvernement, est à son tour modifié par la manière dont ce gouvernement agit, et une modification significative de l'équilibre des forces qui le constituent ne peut manquer d'entraîner la chute du régime établi et son remplacement par un autre. Si on ne cantonne pas cet "esprit général" dans son rôle politique, c'est à peu près ce qu'on désignerait aujourd'hui par le terme de "culture", à condition de le situer au point de départ des énergies créatrices d'une collectivité et non au point d'arrivée de ses célébrations officielles : précisément la situation qu'occupent L'Esprit des lois et son auteur dans notre horizon culturel, si on les enlève aux théoriciens pour les rendre à la littérature.
Contrairement à ce qu'en ont dit certains, hostiles ou trop enthousiastes, L'Esprit des lois n'est pas une bible. C'est, équipé de mille appareillages et dispositifs textuels performants, un laboratoire de la chose politique, où l'on peut fabriquer à loisir une monarchie bien tempérée par les pouvoirs intermédiaires des notables (c'était, semble-t-il, le choix de Montesquieu), un idéal républicain (la Révolution l'a élu parmi ses textes fondateurs), un libéralisme conséquent (ils ne le sont pas tous). Ni finaliste ni mécaniste, son déterminisme est de ceux – Diderot saura s'en souvenir – qui laissent la part belle à la liberté et à l'invention des hommes. Il est bien digne de ce modèle d'homme de laboratoire, de texte et de générosité qu'on appelait alors "le philosophe".