
Les nuages ont fasciné les artistes du XIXe siècle. Ils avaient déjà conquis la faveur des peintres. Instruments d'une symbolique sacrée, ils deviennent dans les tableaux qui admettent le paysage un des éléments de la représentation de la nature. Nombre d'œuvres de l'École hollandaise en portent témoignage ainsi que les études de Constable ou de Turner. La révolution romantique donne au paysage une place nouvelle. En 1843, à Lyon, la moitié des exposants sont des paysagistes. L'École de Barbizon prospère. La littérature s'empare du sujet. Shelley, Baudelaire consacrent au ciel et aux nuages d'admirables poèmes. La science en commence l'exploration : Luke Howard propose, en 1803, à ses contemporains une classification qui intéresse autant les météorologues que les artistes. Avant que le XIXe siècle ait atteint la moitié de sa course, le service des nuages évoqué par John Ruskin se trouve réellement assuré. La photographie participe à ce mouvement dès son apparition. Les photographes en plein air, tout imprégnés d'une iconographie qui les avait ouverts aux beautés de la nature, disposaient a priori des moyens d'en restituer aisément les effets. Mais la reproduction photographique des ciels s'avéra de fait techniquement très complexe. Les photographes eurent donc recours à de nombreux procédés pour les figurer et le sujet devint l'objet d'une vive polémique.


Ciel blanc (négatif noirci).

Ciel solarisé.
On savait dès le début que les préparations chimiques manquaient de sensibilité. La transposition des couleurs dans la gamme brune et blanche de la photographie ancienne n'allait s'opérer ni instantanément, ni en synchronisation, ni dans les rapports de tons déterminés par la perception visuelle. Le bleu (ciel) impressionnait le négatif plus rapidement que le jaune et le vert (végétation). Mais un temps de pose trop court donnait des premiers plans sombres sans gradation de teinte. La production simultanée du ciel et du motif principal s'avérait impossible.
La scène terrestre primant, les ciels, surexposés jusqu'à la solarisation devenaient la règle. La plupart des photographes s'accommodaient de ces résultats en noircissant la zone correspondante des clichés afin d'avoir au tirage des ciels vierges de toute trace de brunissement. D'autres escamotaient la difficulté en cadrant le paysage de façon à garder le moins de ciel possible. Les ciels blancs furent de mise pendant quelques années, puis considérés comme une imperfection nuisant à l'harmonie de l'épreuve.

Ciel rapporté.

Même ciel rapporté.
La mode des ciels rapportés
Dès les années 1840, Hippolyte Bayard réfléchissait
aux moyens d'obtenir des ciels dégradés ou de faire apparaître
des nuages dans le ciel monotone d'une épreuve. Il n'était
pas le seul. Les préparations au collodion et les révélateurs
s'enrichirent de quelques formules destinées à capter les
nuages sur le négatif et à ne pas les perdre au développement.
Les méthodes se multiplièrent parmi lesquelles le système
des ciels rapportés tint une place prépondérante.
Cette technique dédoublait la prise de vue, acte fondamental de
la création photographique, puis confondait les négatifs
par un double tirage du positif final : on obtenait d'abord le motif principal
par contact avec le négatif du paysage, puis on réexposait
l'épreuve sous un négatif de ciel pris ailleurs. Des collections
se constituèrent et des ciels identiques se remarquèrent
sur des paysages différents. "C'est de l'immoralité
artistique" notait Robinson en voyant les mêmes ciels sur des
photographies exposées par des auteurs différents.


La production de ciels à part aurait pu conduire à des séries comparables aux suites peintes par Constable et, peu après, par Eugène Boudin. C'était possible techniquement : quelques marines de Gustave Le Gray où la mer est presque sacrifiée, une étude d'Achille Quinet le montrent. La liste n'est pas close, mais ce sont en France des cas isolés, fruits de la curiosité d'un instant ou exercices de virtuosité. Les nuages, seuls, n'intéressaient pas les photographes.

L'impuissance fonctionnelle de la photographie, en ce premier âge de la découverte, à rendre le "simple dehors des choses" (Stieglitz), ne fermait pas à ses adeptes le chemin du ciel. La déambulation dans les sentiers battus par les arts du dessin les en a détournés. À leurs yeux, le ciel restait un décor qu'il était gratifiant de fabriquer, puis d'assortir à un sujet. Leur savoir-faire manuel trouvait à se satisfaire dans la sélection et la mise en œuvre de l'une des formules ou méthodes divulguées. Leur goût se complaisait dans la réalisation et la finition d'images négatives pour des tirages où le ciel adroitement choisi et juxtaposé jouerait son rôle de "grand régulateur de l'air, de la lumière et de l'harmonie" (Dillaye). À ce jeu, les réussites furent d'ailleurs peu nombreuses même chez les photographes les mieux inspirés. Les compositions les plus belles de Le Gray n'approchent que de loin telle marine d'Edgar Degas.

Les ciels d'emprunt
En 1861, les échos d'une querelle sans cesse renouvelée
entre les adversaires et les partisans de la retouche des épreuves
résonnent dans les colonnes des revues photographiques. Le ciel
en est l'enjeu.


H.P. Robinson proclame la supériorité du ciel rapporté sur le ciel naturel qui, selon lui, est rarement approprié au paysage au moment où l'on photographie ce dernier.
Les clichés de nuages naturels supplantent les ciels peints encore utilisés autour de 1870 et dont l'emploi est condamné par Eugène Durieu dans sa réponse à Paul Périer en 1855 : "chaque art doit trouver sa véritable puissance en soi-même, c'est-à-dire dans l'emploi habile des procédés qui lui sont propres ; et, pour rentrer dans le sujet spécial qui nous occupe, appeler le pinceau au secours de la photographie sous prétexte d'y introduire de l'art, c'est précisément exclure l'art photographique." (Bulletin de la Société française de photographie, 1855).



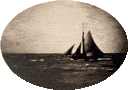
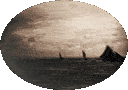
Sur le plan de l'authenticité, les ciels rapportés étaient aussi contestables que les ciels dessinés et autres expédients qui permettaient d'obtenir de faux nuages sur l'image définitive. La vue simulait une réalité ; la représentation finale était fabriquée ; vrai en chacune de ses parties, le paysage qui résultait de leur combinaison était falsifié.
Toutefois, cette méthode pouvait échapper à la critique de Durieu puisqu'elle se présentait comme le redoublement prémédité d'opérations strictement photographiques : la prise de vue et le tirage. Sauf peut-être de la part de Fierlants, les justes reproches qu'elle suscitait s'adressaient moins au processus qu'aux résultats. Elle requérait en effet de grands soins, un sentiment artistique sûr, un sens de l'observation aiguisé ; peu de photographes réunissaient ces qualités.
Des anomalies choquantes engendraient un effet contraire à ce qu'on voyait dans la nature : ciel plus foncé à l'horizon qu'au zénith ; firmament éclairé d'un côté, paysage de l'autre ; nuages habilement disposés, mais oubli des ombres portées sur la campagne.

Ciels naturels rapportés, ciels artificiels estompés ou blanchis, aux nuages dessinés ou découpés, ces recettes et tours de main s'appliquèrent en se perfectionnant jusqu'à l'avènement des émulsions au gélatino-bromure d'argent et même après. Il y a donc peu de ciels véritables dans les épreuves photographiques du XIXe siècle, et il y en a souvent d'invraisemblables. Pourquoi l'invention de Niépce et de Talbot a-t-elle dû se résoudre à enregistrer des paysages sans l'élément qui participe, chaque fois et de manière au moins subliminale à l'impression d'ensemble ? Comment a-t-elle pu laisser échapper "les nuages qui passent... là-bas... les merveilleux nuages !" qui inspiraient Baudelaire, les poètes, les arts et les sciences ?
N'étant devant l'objectif ni des beautés météorologiques
ni des abstractions, les nuages se sont ri des photographes jusqu'à
l'aube du XXe siècle. Ils ont
alors éveillé d'autres regards, suscité d'autres
approches. Les "Équivalents" d'Alfred Stieglitz en marquent
avec éclat la nouveauté.
| Ressources documentaires | |
