| Les
éditions d'art
: une révolution iconographique au XIXe siècle |
|
|
||||||||||
|
La
lithographie fait entrer l'illustration dans le siècle de l'industrie |
|||
 |
Au XIXe siècle, l'illustration occupe trois
pôles :
|
||
|
La
lithographie fait entrer l'illustration dans le siècle de l'industrie |
|||
 |
|||
|
Cette planche composée
de deux illustrations appartient à un ensemble de onze images consacrées
à l'histoire de Cendrillon : à gauche, la marraine semble tranquillement
bavarder avec sa filleule croulant sous le poids d'un immense potiron,
alors que sur la gravure de droite, d'un geste décidé, elle le transforme
en un magnifique carrosse d'un coup d'épée magique. La lithographie fluidifie
littéralement le trait en estompant les contours et en noyant la scène
sous un grisé particulièrement harmonieux. Les ombres des personnages
se détachent nettement, renforçant davantage le jeu de l'alternance des
noirs et blancs entre lesquels s'immiscent toute une variété incommensurable
de gris.
|
|||
|
Gustave
Doré, un illustrateur visionnaire ? |
|||
|
Cette révolution de
l'illustration au XIXe siècle est incontestablement dominée par Gustave
Doré qui va donner à cet art ses lettres de noblesse, même s'il est précédé
par d'illustres précurseurs, comme Gavarni Grandville ou Tony Johannot
qui adopte en France la technique de bois de bout [sur bois de bout :
le bois, débité perpendiculairement au fil (procédé découvert au XVIIIe
siècle par Bewick ) est travaillé au burin ( gravure fine )]. |
|||
| |
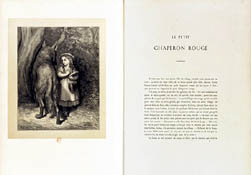
L'éditeur Hetzel, dès son retour d'exil en 1860, commence une longue collaboration avec Gustave Doré qui verra en particulier la parution des Contes de Perrault en 1862. Hetzel, républicain de 1848, très engagé dans la vie politique et le monde littéraire, s'entoure alors des représentants les plus éminents du monde intellectuel de son époque comme George Sand, Balzac, Jules Verne ou Camille Flammarion. Gustave Doré qui a tout juste trente ans, a conçu un grand projet, celui d'illustrer les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature occidentale. Commençant par L'Enfer de Dante, il en vient tout naturellement aux contes de fées avec la comtesse de Ségur et Charles Perrault. Dessinant directement sur le bloc à l'encre de chine ou au lavis, il renouvelle la gravure sur bois par le bois de teinte, rendant à merveille les diverses nuances et jeux de contrastes. Remarquablement servis par des graveurs de talent comme Adolphe-François Pannemaker ou Héliodore Pisan, les quarante "tableaux" illustrant ce "très grand livre, très cher" se répartissent inégalement : donnant lieu à onze planches, Le Petit Poucet est de loin le conte qui inspire le plus l'artiste. Des disproportions effrayantes, des détails saisissants, la profondeur des forêts fantastiques font de cette œuvre une des interprétations les plus magistrales des Contes de Perrault. Le Petit Chaperon rouge donne lieu quant à lui à trois images qui sont particulièrement intéressantes. |
||

|
La première de ces
illustrations en pleine page montre la rencontre de la petite fille avec
le loup. Celui ci est représenté de dos, sa taille gigantesque dépassant
largement celle de la fillette portant sa galette et son petit pot de
beurre. Pointant son index tendu dans une direction qui semble évoquer
le chemin à suivre pour arriver jusque chez la Mère'grand, la petite fille
ne montre aucun signe d'inquiétude face à ce grand loup. |
||

|
La seconde illustration
montre le petit Chaperon rouge et le loup, couchés dans le même lit, juste
avant la dévoration. La petite fille, fascinée et intriguée, semble en
même temps révulsée. Alors que tout son comportement hésite entre l'attirance
et la répulsion, elle maintient le drap d'un geste pudique sur son épaule
droite alors que ses yeux semblent dire au loup le contraire de ce que
son geste évoque. L'agressivité de l'animal est manifestée par ses griffes
sorties ainsi que par son regard avide. Ayant remplacé son chaperon-béret
par un bonnet de nuit en dentelles, les cheveux dénoués, symbolique traditionnellement
érotique, l'enfant semble plus mûre que dans la première illustration.
L'opposition des regards croisés crée un moment de suspense dramatique
qui laisse présager un dénouement brutal. Mais le travestissement du loup
peut aussi prêter à sourire, car celui-ci a revêtu le bonnet de nuit enrubanné
de la grand'mère et on peut bien sûr se demander pourquoi la petite fille
ne le démasque pas. Car n'est-ce pas la grand'mère qui s'est déguisée
en loup, pour faire peur à sa petite fille ? N'est-ce pas elle qui se
dit conteuse, et se précipite sur l'enfant pour la dévorer (de baisers
?) comme l'indique l'annotation au manuscrit de 1695 : "On prononce ces
mots d'une voix forte, pour faire peur à l'enfant comme si le loup l'alloit
manger".
|
||
|
Arthur
Rackham, un maître de la féerie illustrative |
|||

|
Illustrateur de la
féerie par excellence, Arthur Rackham fait des légendes et récits merveilleux
son domaine de prédilection. Il met en image Le Petit Chaperon rouge
dans la version des frères Grimm pour un recueil qui fut complètement
refondu par Charles Guyot. La scène est construite autour d'une diagonale
qui par du bonnet de nuit du loup pour aboutir au bas du dos de la fillette
en passant par les deux paires d'yeux des protagonistes. On retrouve ici
le lourd rideau du lit à baldaquin aux motifs surchargés, tout comme le
couvre-lit de la Mère-grand et la jupe de la fillette, très éloignés du
modèle campagnard. Cette dernière est revêtue d'une capeline avec capuche
entièrement rouge dont l'à-plat contraste fortement avec les arabesques
des autres tissus et le blanc des draps qui semblent inviter la fillette
. Celle ci hésite, ne sachant finalement quelle attitude adopter. Les
deux pieds fermement campés sur le sol, elle repousse de la main gauche
la lourde tenture comme pour dévoiler aux regards de tous le loup déguisé.
Aucun sentiment de peur ou d'effroi ne semble l'affecter, alors que le
loup manifeste quant à lui bien des signes d'agitation et de fébrilité.
Arborant le bonnet de nuit de l'aïeule, ainsi que ses lunettes, comme
pour accentuer le comique de la situation, la gueule ouverte, sans craindre
d'exhiber sa dentition quelque peu effrayante, ses grosses pattes d'ours
retenant la couverture jusqu'au menton, c'est lui qui de manière singulière,
affiche une pudeur fort peu appropriée. Il est vrai que nous sommes dans
la version Grimm, et que celle-ci se termine bien pour l'enfant mais très
mal pour le carnassier dans les deux versions collectées : dans un cas
un chasseur lui ouvre le ventre et le remplit de pierres ce qui le fait
périr d'indigestion. Dans l'autre version, le Petit Chaperon échaudé rencontre
un autre loup mais court aussitôt chez sa grand'mère et les deux femmes
se débarrassent de l'intrus en le précipitant dans une auge. Nous sommes
loin ici de la fin cruelle à la manière de Perrault et il semble bien
que l'illustrateur ait choisit délibérément de ne point provoquer l'effroi
chez les lecteurs.
|
||